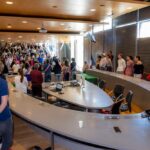Le texte de l’autrice Florence Laude :
“J’ai découvert le travail d’Alain Pontarelli en poussant la porte de la Galerie Jean-François Meyer à
Marseille, en février 2016. L’exposition, poétiquement intitulée « Conversation saphique dans une
arrière-cour », tenait largement ses promesses de prendre le sujet à rebours de certains codes de la
sculpture traditionnelle, de privilégier le discours subversif, de jouer avec le spectateur sur le mode
ironique et décalé. J’avais trouvé culoté de la part d’un homme de présenter son œuvre comme « une
conversation saphique », mais il s’avéra que ses sculptures représentaient justement de nombreuses
culottes, corsets, rubans noués et talons hauts, emblèmes d’une certaine féminité, ou plutôt d’un
certain regard, un regard masculin, sur la féminité, avec lesquelles le spectateur avait de quoi satisfaire
un penchant pour l’érotisme et trouver plaisir à regarder une œuvre libre et colorée. Pousser la
porte d’une galerie d’art et se retrouver dans l’arrière-cour d’un salon de lingerie féminine, était un
plaisir qui se révélait, à y regarder de près, très ambigu. Il ne suffisait pas d’entrer et de voir, mais
d’engager la conversation avec les œuvres, au sens ancien, de vivre avec et de les fréquenter. Passer
dans l’arrière-cour, c’était quitter une représentation de vitrine, celle qui se contente d’un coup d’œil
vite fait, pour comprendre les objets d’un autre point de vue, pour entrer dans le jeu de l’artiste. Ses
sculptures sont des artifices séduisants et des œuvres dangereuses à plus d’un titre.
Au fil des expositions sans prétendre tout comprendre de l’œuvre d’Alain Pontarelli, j’ai tenté le
dialogue et je propose ici une conversation à partir de l’exposition de 30 ans et après… qui s’est tenue
fin 2018, début 2019 à l’Hôtel des Arts de Toulon et des œuvres créées pour le musée des Gueules
Rouges à Tourves.
A Toulon, au rez-de-chaussée, dans la salle à droite en entrant, on découvrait les oeuvres
intitulées Papillon du Maroni, Mains courantes du Maroni, L’écorché du Maroni, Sentier du Maroni,
Colonie du Maroni.
Maroni, Maroni, Maroni, le nom du fleuve frontière entre la Guyane et le Suriname, grondait d’un mur
à l’autre. Maroni, Maroni, Maroni, rythme ternaire envoûtant, le choc du pic des chercheurs d’or, du
marteau du forgeron qui, inlassablement, cognent comme les coups de matraque qui font plier
l’homme et redressent les torts. Maroni, Maroni, Maroni, les cloisons de la salle dressées comme les
murs d’une cellule, renvoyaient le mot, pas d’issue au cachot. Maroni, Maroni, Maroni, l’omniprésence
de ces mains géantes, comme les poings serrés du bagnard pour contenir son cri, pendant que les
mains du garde chiourme, crispées sur sa trique, égrènent les coups. Maroni, Maroni, des centaines
de papillons étoilaient le mur et transperçaient la blancheur immaculée des parois de cette grande
boîte d’entomologiste et pas moyen de faire taire le cri lancinant des trois syllabes. Maroni,
aujourd’hui tes eaux rouillées lavent la souillure du bagne, on n’entend plus que ces trois syllabes
froissées par le vent dans les feuilles.
Là, dans la salle de l’Hôtel des Arts de Toulon, les ossatures de fer tors fermé, soudé, figurant des
exosquelettes de mains bourrées jusqu’à la gueule de feuillages séchés, s’inscrivaient comme le trait
d’union entre le bagne de Guyane et Toulon qui partageaient une histoire lourde comme l’acier et
sauvage comme la végétation de palmes. Avec le silence qui temps qui est passé, les accents douxamers du poème de Verlaine évoquant la prison belge où il purgeait sa peine : « Le ciel est, par-dessus
le toit, /Si bleu, si calme ! / Un arbre, par-dessus le toit, / Berce sa palme. / La cloche, dans le ciel qu’on
voit, / Doucement tinte. / Un oiseau sur l’arbre qu’on voit / Chante sa plainte -Qu’as-tu fait, Ô toi
que voilà / Pleurant sans cesse, / Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, / De ta jeunesse. » Sagesse (1881)
Des mains colossales, seulement des mains, pour évoquer le bagne, le bagnard et le travail forcé, pour
signifier que le bagnard perdant sa liberté n’est plus un homme, mais une force de travail à perpétuité,
réduite à ses mains. Des mains, pour marquer la brutalité du rapport de force entre celui qui reçoit les
coups et celui qui les donne, une histoire de poings dans un enfer vert.
2
Ce qui apparaissait dans cette exposition, c’était le poiein , c’est-à-dire l’acte de transformer, de
produire et de créer des objets de manière à ce que, comme en poésie, l’objet qui désigne une chose
acquière des significations plus vastes, par le travail de la mise en forme. Là, les installations étaient
poétiques, grâce à l’économie des moyens et à l’exploitation de toutes les ressources de formes, de
matières, de situation dans l’espace, auxquelles s’ajoutaient des mots, par l’intermédiaire des cartels
et des titres. Une œuvre figurative qui invente des objets inédits, séduisants pour l’œil et intrigants
pour l’esprit, des énigmes ouvertes à de multiples interprétations.
Pour l’exposition au Musée des Gueules Rouges de Tourves, les pièces créées mêlent des matériaux
variés, fer tors, tôles, végétaux, bois brut, vêtements façonnés ou chiffonnade de tissus légers et tous
ont exactement la même valeur artistique. Tous doivent être considérés au même degré dans le geste
artistique et pour le potentiel poétique, les pièces fabriquées de la main de l’artiste (les yeux, les mains,
les couronnes, les cœurs) et les matériaux récoltés (veste, chapeau, lunettes, pieds de table en bois,
chevrons, etc.). Il n’y a pas de hiérarchie entre les objets créés et les objets récoltés, de même qu’il
n’y a pas de hiérarchie entre les mots d’un poème, il y a des mises en forme choisies qui favorisent des
rencontres poétiquement organisées, qui transforment les propriétés rationnelles des objets et leur
permettent d’augmenter leur potentiel signifiant et d’exprimer plus que ce que les objets eux-mêmes
ne le pourraient.
Organiser des chocs visuels, chercher le contraste des textures et renouveler les sensations qu’elles
transmettent : fer/bois, fer/mousseline de tulle, fer/verre. Le choc est encore de rapprocher des objets
de factures différentes, le fabriqué et le ready-made duchampien.
Le geste du sculpteur qui fabrique à partir d’acier, de fer tors ou de tôle est celui de ferronnier-métallier
et renvoie au monde ouvrier et à l’histoire familiale d’Alain Pontarelli, le grand-père et le père de
l’artiste ayant travaillé pour les chantiers navals de La Seyne-sur-Mer. A cela s’ajoute le procédé de
peinture thermolaquée, couramment utilisé dans l’industrie automobile. Enfin, Pontarelli n’exclut pas
de produire en série et de fractionner son travail en étapes simples, élémentaires, exécutées de façon
répétitive au nombre d’exemplaires visé. Toutefois, chaque pièce est unique, artisanale. Et c’est un jeu
de construction et de création efficace et ludique. Alain Pontarelli intègre deux concepts que l’on a
opposés au cours du XXe siècle, la sculpture traditionnelle qui crée des formes et le ready-made
duchampien, qui déclare que l’objet manufacturé a le statut d’œuvre d’art du moment qu’il est regardé
en tant que tel. Il en imagine donc un autre dans le parcours de l’exposition, le choc des concepts et le
jeu décalé, pour instaurer un mode de dialogue avec le spectateur, un mode ludique et intelligent qui
le place comme acteur dans la construction du sens.
Il faut d’abord revenir sur la notion de jeu et de plaisir. Le plaisir de créer, visible dans l’abondance
des œuvres réalisées, je pense à la pièce produite à trente exemplaires pour Le mur qui regarde, ou le
déploiement d’une forme (les lunettes) en une multitude de propositions décalées et colorées, sorte
d’exercice de style oulipien, de la série Optique : Optique tribal, Optique anémone, Optique feuillu,
Optique fuoco, Optique palmes enneigées, Optique kabuki, Optique patte d’oie, Optique x ray. Une
fascination pour les yeux, le regard, les lunettes, le masque. Une fascination pour tous les accessoires
qui sont des écrans entre le regard et la réalité qu’ils habillent, travestissent ou permettent de voir
autrement. Quelques masques semblent adopter le principe de camouflage, mimer pour se cacher,
rencontré chez certains animaux et certaines plantes pour ne pas se faire voir de leur prédateur, ou
pour attraper leur proie : mimer la feuille, mimer la fleur, mimer le flocon de neige, etc. D’autres sont
des masques pour voir au-delà du visible : Optique x ray. Masques, donc, invitant à accéder à une
réalité poétique, alternative aux réalités triviales qui sont notre lot quotidien, comme aux réalités
augmentées ou virtuelles qui rencontrent, aujourd’hui, tant de succès. L’objet artistique, la pièce ou
l’œuvre, appelons-le comme on veut, est un objet augmenté qui exerce le regard différemment, il n’est
pas un objet-outil utile au sens trivial, il n’est pas un ready-made de la pensée, non plus, il est une
forme attractive, sensible et intelligente. Regardant les Optiques d’Alain Pontarelli, je pense à certains
films de Michel Gondry, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), La Science des rêves (2006),
3
Soyez sympas rembobinez (2008), Microbe et Gasoil (2015), autant de films dans lesquels la place
accordée aux objets détournés artisanalement est fabuleuse, délirante, poétique, parodique et
critique au second degré. Interrogé à leur sujet, Michel Gondry dit vouloir « des objets réalistes, lowtech, inquiétants par leur côté non professionnel, de manière à désacraliser la technique ». Si,
esthétiquement, les œuvres de Pontarelli ne rejoignent pas celles de Gondry, on apprécie chez l’un et
l’autre le goût persistant pour l’objet rappelant le jouet (même quand il est érotique), proposé comme
un objet à la fois technique et artistique, réel et imaginaire, qui a le pouvoir de déranger, d’amplifier
et de renverser le regard.
Les Optiques accrochées au mur à hauteur de regard nous observent autant que nous les observons.
Elles sont les spectateurs d’une tragi-comédie où chaque œuvre est un personnage que le regard du
spectateur vient animer, il n’est pas seulement celui qui regarde, il est en interaction avec les œuvres,
il fait partie du dispositif. Le Mur qui regarde, est un mur de spectateurs faisant du visiteur un acteur.
Il est aussi une variante de l’avertissement « les murs ont des oreilles », et rappelle les caméras de
surveillance omniprésentes et la dérive sécuritaire de nos sociétés, dénoncée dès la fin des années
quarante, par Georges Orwell, dans le roman 1984. Objet composite associant des lunettes noires à
un nez de clown, reproduit à une trentaine d’exemplaires, le Mur qui regarde joue sur le renversement
de la posture de l’œuvre et du spectateur. Si avec Marcel Duchamp, l’objet devient œuvre d’art du
moment qu’il est déclaré tel par la volonté de l’artiste qui le présente dans un espace d’exposition, ici
les dispositifs d’exposition et les œuvres, précisément les Optiques, sont voulus pour amplifier la
position critique de l’objet par rapport au spectateur en exhibant la place et le pouvoir dissimulé de
l’objet dans la société de consommation et de culture de masse. En faisant disparaître la fonction
prosaïque de l’objet, en le couvrant de couleurs rutilantes, en lui ôtant sa fonctionnalité, il révèle leur
pouvoir hypnotisant et séducteur mais pourtant dangereux, voire toxique. Notre relation aux objets
est ainsi interrogée, sacralisation de l’objet, désir de divertissement, aveuglement face à la réalité.
C’est le sens que l’on peut donner à Bilboquet, une œuvre composée de deux mains de fer reliées par
des chaînes, dans lesquelles sont fichés des bâtons en bois tourné. Le titre de l’œuvre renvoie à un jeu
d’adresse, à un pur divertissement, impraticable ici, et on pense plutôt aux expressions, il s’est fait
taper sur les doigts, il s’est pris un retour de bâton. Les puissantes mains d’acier ou gants d’ouvrier,
évoquent des équipements de protection individuelle, rendus inutiles et hors d’usage, pendant à
l’extrémité de chaînes qui les entravent.
Pour revenir aux Optiques, l’accessoire clownesque dont elles sont ornées, les couleurs attractives qui
en jettent, les paillettes qui nous font de l’œil, nous les rendent sympathiques et privilégient la
perception de masques de comédie burlesque dans la pure tradition de la commedia dell’arte
italienne. La pièce Optique Kabuki évoque le théâtre japonais dans lequel les formes, les couleurs et
les sons vont atteindre les spectateurs en des points précis de leur organisme. De ces formes
théâtrales très physiques, Antonin Artaud tira le concept de Théâtre de la Cruauté, un spectacle total
« qui nous réveille : nerfs et cœur ». Du masque à la comédie, de la comédie à la satire sociale, la suite
de l’exposition est un défilé de personnages tragi-comiques, marionnettes et épouvantails, jouant de
leur mimétisme anthropomorphique, de leurs accessoires amusants, à première vue dérisoires et
humoristiques, bonnet de lutin, chapeau de paille, nœud papillon et couleurs vives pour séduire et
flatter le spectateur, avant de lui décrocher une vérité coup de poing.
Portant bien et Round Up l’Epouvantail, sont deux pièces significatives à cet égard. Ces deux sculptures
conçues selon le même principe, un crâne en fer tors soudé garni de tulle coloré, coiffé d’un bonnet
pointu rouge pour le Portant bien et d’un chapeau de paille pour Round up l’Epouvantail, fiché au
sommet d’une structure en bois brut à mi-chemin entre la croix et le poteau de direction qui évoque
aussi un squelette humain. Au bout des bâtons servant de bras, de solides mains en ferraille. A la place
du col, un large nœud papillon en métal découpé, laqué en noir brillant, comme les hommes en
smoking en portent pour parachever leur tenue de soirée. Mais, la fête est finie ! En place du sexe ou
du slip kangourou, un gros nœud en tôle découpé, laqué blanc, allusion sexuelle évidente. Round up
l’Epouvantail, perçu comme tel au premier regard, est un dérisoire unijambiste claudiquant sur son
4
unique sabot, une allégorie de la mort. Round up, épelé ici en deux termes, est une allusion au
rassemblement des victimes de la puissante firme Monsanto, productrice de l’herbicide Roundup.
L’issue du procès n’est pas tranchée, qui sera le gagnant ou le perdant du match juridique qui les
oppose, up or down ? Portant bien est à la croisée des chemins entre le pantin de bois Pinocchio, le
Père-Noël et l’image d’Epinal de l’ouvrier, son couvre-chef pointu rouge rappelle le foulard rouge de
la tenue traditionnelle des mineurs, et plus généralement des ouvriers, mais là encore, le crâne exhibe
l’ironie de l’objet, à rebours d’une lecture idéalisée, lénifiante et trompeuse, ni le mineur, ni l’ouvrier
ne sont bien portant dans l’ère post-industrielle ! Jouets et pantins d’une économie capitaliste, ils sont
les victimes sacrifiées sur l’autel du profit.
Sans fioriture et sans ironie cette fois, Col bleu et mains rouillées est un vibrant hommage au monde
ouvrier. Un cintre métallique est revêtu d’une véritable veste de mineur de coton bleu, les manches
se terminent sur des mains en fer tors soudé, laissées dans leur apparence de fer brut, rouillé. Elles
sont démesurées. Cette sculpture qui est une allusion au vestiaire des mineurs, fait l’éloge du travail
manuel et de la condition ouvrière, mais la démesure des mains rouillées est tragique.
L’éloge est comparable dans les œuvres Pelle à charbon et Workers’arms. Pelle à Charbon est
constituée d’une pelle usagée et de deux volumes en forme de mains, magnifiquement sculptés. Cette
œuvre transmet une émotion. On dirait des gants d’ouvriers déformés par l’usure qui garderaient à
jamais la forme sensible des mains qui s’y étaient glissées. Déposés sur le plateau de la pelle, ils
semblent des offrandes à une divinité. Workers’arms est composé de deux pelles de mineur posées
côte à côte. Le manche est prolongé par une main sculptée enveloppée d’une mousseline noire, qui
en épouse la forme comme un bas galbe la jambe d’une femme. Le surgissement de l’accessoire
féminin dans cet objet viril, issu d’un univers essentiellement masculin interpelle. De façon similaire,
les nombreux crânes visibles dans l’exposition, sont garnis de tulle, tissu léger aux couleurs vives,
intéressant pour le contraste de matières qu’il introduit par rapport au fer et pour l’évocation de la
femme, comme une obsession en creux, lovée à la place du cerveau. On peut se demander s’il faut y
voir une quelconque transposition du dessin qui par illusion optique, superpose le corps nu d’une jeune
femme au profil de Freud, intitulé What’s on man’s mind ? L’obsession pour la féminité est encore
explicite dans La Bouche charbonneuse, une bouche de métal aux lèvres rouges et pulpeuses, brillantes
comme une carrosserie de berline américaine, d’inspiration Pop’Art. Visuellement c’est une synthèse
de la bouche de Marylin Monroe, du canapé en forme de bouche que Dali réalisa pour le musée de
Figueras et une allusion à l’affiche du film de Federico Fellini, la Città delle Donne (1980). Séductrice
et sexy, la bouche d’Alain Pontarelli est charbonneuse. Parée d’un voile noir, elle exprime le deuil et la
mort, rejoignant l’image d’une femme, sexuellement désirable mais inquiétante et dangereuse que
l’on trouvait dans l’exposition « Conversation saphique dans une arrière-cour ». Poursuivant le chemin
de l’obsession sexuelle, la mine de charbon, peut aussi être perçue comme une bouche, ou un orifice
inquiétant et dangereux dans lequel les ouvriers pénètrent. L’esthétique Pop’Art à laquelle se réfère
la sculpture d’Alain Pontarelli, tend toujours à exhiber la séduction comme un leurre potentiellement
dangereux qui aveugle le réel.
Ici, au Musée des Gueules Rouges, Alain Pontarelli nous parle de la fin d’une époque industrielle et de
la muséification du monde ouvrier. Carré noir sur fond avec mains en écart, peut-être vu comme
allusion à l’œuvre Carré blanc sur fond blanc de Malevitch, où l’artiste russe poursuivant
l’expérimentation sur la couleur à l’extrême, parvient à ce que l’on a considéré comme la mort de la
peinture. En parallèle, l’œuvre de Pontarelli montre le cynisme d’une logique économique capitaliste
qui poussée à l’extrême, crucifie l’humain. En ce sens, elle est aussi comparable au Carré noir sur fond
blanc du même Malevitch, exposé à l’endroit où l’on expose les icônes dans les maisons paysannes
russes. Le carré noir de la sculpture d’Alain Pontarelli évoque le carreau de mine, lieu de travail et de
souffrance, que le processus de muséification sacralise, après qu’il a été sacrifié sur l’autel de la
5
rentabilité, par le capitalisme. Pour cette raison, cette œuvre peut-être vue comme une icône. L’Idole,
autre pièce de l’exposition, peut être comprise de façon sensiblement analogue pour sa dimension
provocatrice et spirituelle. L’Idole figure un Christ en croix, deux chevrons de bois brut forment la
croix, le corps disparaît, seuls les ornements en métal découpé et peint symbolisent certains repères
classiquement présents dans les sculptures et les peintures de crucifixion : l’auréole, la couronne
d’épine, le sacré cœur, le pagne noué autour des hanches et les clous. Mais, l’ensemble est traité dans
le langage formel pontarellien, on voit des couleurs de panoplie de déguisement d’infirmière, le blanc,
le rose, mais alors d’infirmière sadique, puisque les clous et l’auréole sont figurés comme de larges
bracelets de métal, garnis de pointes, à l’instar des bijoux punks et des accessoires sado-maso.
L’auréole jaune d’or est elle-même agrémentée de pointes qui la font ressembler à une couronne
d’épines ou un collier pour chien-méchant. Comme on l’aime, celui qu’on a torturé à mort ! L’Idole
interroge le choix de l’image de la crucifixion comme icône dans la religion chrétienne et elle dénonce
d’une tentative de sanctification de la condition ouvrière, après que la classe ouvrière a été mise à
mort. Allusion douce-amère aux chantiers navals et aux carreaux de mine, deux industries issues de la
révolution industrielle du XIXe siècle, qui n’ont pas survécu au capitalisme triomphant.
Comme ultime figure de cette comédie grinçante, je veux évoquer Les Gueules Rouges, une
accumulation de crânes en fer tors rouillé regroupés en grappe, chacun sensiblement à taille humaine.
Leur boîte crânienne, est garnie de tulle qui apporte la note de couleur rouge, rouge comme la vie,
rouge comme la passion, rouge comme le sang. Par delà la mort, ils portent cette tache comme des
stigmates. Etrange vision ! On croirait qu’ils viennent, serrés comme ils le sont, de remonter du fond
de la mine dans la cage de fer rouillée, comme leurs os rouillés, contenant et contenu confondus ! un
groupe macabre échappé des catacombes ou du jugement dernier, ils figurent les mineurs et plus
largement la classe ouvrière sacrifiée sur l’autel du profit. Les crânes des uns et les crânes des autres
sont absolument semblables, après la mort, rien ne distingue plus l’ouvrier du contremaître, le
contremaître du grand patron. Les paroles de la chanson Armstrong, de Claude Nougaro résonnent :
« Au-delà de nos oripeaux/ Noir et blanc sont ressemblants/ Comme deux gouttes d’eau… ». La mort
est l’ultime leçon pour les aveugles du cœur, vainement accrochés à la quête de richesses matérielles.
Memento mori, souviens-toi que tu es mortel.
Plus que jamais, les œuvres anthropomorphes d’Alain Pontarelli, sous un masque ludique, semblent
révéler un drame qui interpelle notre humanité.”